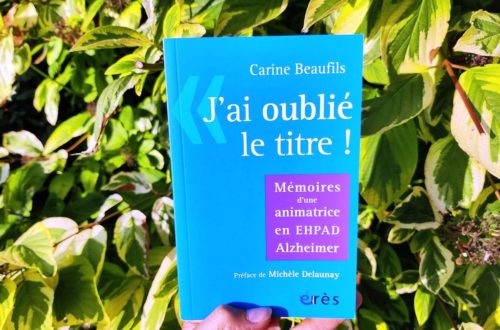Livre « Agriculteurs : les raisons d’un désespoir »
Les agriculteurs font parler d’eux depuis quelques mois. Aujourd’hui, je vous invite à lire une sélection de citations du livre de Arash Derambarsh et Éric de La Chesnais : « Agriculteurs les raisons d’un désespoir » paru en 2017 et que j’ai lu pour ma part en 2020.
Il traite de l’agriculture et de l’agro alimentaire avec des sujets d’actualité comme le gaspillage, la surproduction, la malnutrition ou encore la pollution. Ce n’est pas le genre de livre que j’ai l’habitude de lire mais c’était intéressant (malgré des passages un peu plus ennuyant pour moi) et j’ai apprécié les thèmes abordés.
La préface est signée Brigitte Gothière, co-fondatrice de L214. Il s’agit d’une association de défense des animaux utilisés comme ressources alimentaires. Elle souhaite montrer à tous ce que l’on ne voit pas (ou que l’on ne veut pas voir) : les conditions de vie, de transport et d’abattage des animaux… Ils diffusent régulièrement des vidéos d’enquêtes filmées. Leur but ? « Soulever la question animale auprès des citoyens et dans le débat public. Faire reculer les pires pratiques d’élevage, de transport et d’abattage. Promouvoir l’alimentation végétale pour réduire le nombre d’animaux tués. »
N’hésitez pas à allez sur leur site internet : https://www.l214.com/ et les suivre sur les réseaux sociaux.
Extraits du livre
« Quelque chose ne tourne pas rond dans l’agro-alimentaire, dans la façon de produire, transformer, distribuer et utiliser les ressources alimentaires. »
« On navigue dans des degrés d’horreur pour les animaux, au nom de religions ou de la consommation, de l’égoïsme, de l’indifférence, de l’inconscience collective. »
« La terre, valeur essentielle de notre société, fondement même de notre civilisation, perd de sa valeur. Pendant des millénaires, les agricultures ont formé la colonne vertébrale de la France : sans eux, le pays n’existait plus. Ils étaient producteurs de biens, de richesse, de vivres, d’idées, le moindre lopin de terre représentait quelque chose : il y avait là une pérennité, une certitude, une densité. Une poignée de glaise, un sillon de labour, un carré de blé étaient des symboles. On en héritait, on se passait cette terre de génération en génération, et, silencieusement, les paysans faisaient vivre le pays. »
« Hier, pas si loin que cela, dans les années 1950, on trayait les vaches à la main, on ramassait l’herbe à la fourche, on faisait la pâtée de cochons dans un grande bassine et on la portait manuellement à l’auge. Les chevaux tiraient la charrue dans les champs. Maintenant, la traite des vaches est automatisée voire totalement remplacée par un robot, on laboure à l’aide d’un GPS, on appuie sur un bouton pour délivrer la nourriture aux animaux qui a été concoctée automatiquement dans des grandes marmites industrielles. Certes, l’automatisation des tâches a rendu le travail moins difficile physiquement, mais au détriment de l’isolement. C’était un travail de traditions, de coutumes, de gestes hérités ; c’est devenu un emploi de précision, mettant en avant la technicité informatique et agronomique. Oubliant que la nature du métier porte sur du vivant : des sols et des animaux. Le paysan n’étant plus considéré que comme le maillon d’une chaîne de production, l’agroalimentaire, comme le serait un salarié sur une chaîne automobile. »
« (…) il est important de savoir d’où vient le contenu de notre assiette. Le lait, contrairement à ce que croient certains gosses, ne vient pas en briques. Le poisson n’est pas conçu par la nature en carrés. La viande n’arrive pas sous vide. »
« Notre société est une société d’abondance. Ça déborde. Du coup, on jette. »
« Les politiques, avant de se décider, prennent leur temps. La planète a-t-elle encore le temps ? »
« Pendant ce temps-là, entre agriculteurs aussi, on restructure et modernise les exploitations. C’est la course à l’agrandissement et à l’élimination des plus petits et des plus faibles. De 1970 à 2010, la surface moyenne des fermes françaises est ainsi passée de 21 à 55 hectares. Avec pour résultat immédiat une réduction du nombre d’exploitations de 1,6 million à 490 000 et même 450 000 aujourd’hui. En 1970, on pouvait vivre avec 5 hectares et trois vaches. Aujourd’hui, même à 53 vaches (taille moyenne du troupeau laitier français) et 77 hectares (superficie moyenne des exploitations), l’agriculteur a du mal à vivre. »
« Il a fallu moins de bras, avec la mécanisation, tandis que la chimie augmentait les rendements. Du coup, les paysans inactifs, ou leurs enfants, sont « montés » à la ville pour devenir ouvriers ou chômeurs. Et les produits de synthèse, qui ont démultiplié les récoltes, ont empoisonné la terre – et souvent nos assiettes. »
« […] ce monde-là qui, autrefois, était simple – manger, dormir, travailler (et parfois aller au bistrot) – est devenu d’une incroyable complexité. Personne, au fond, ne se repère totalement dans cet enchevêtrement administratif, dans cet imbroglio de recommandations, dans cette cohue de choix à faire. Il faudrait être ingénieur, geek, chimiste, financier, commerçant, stratège et écologiste. Le paysan d’aujourd’hui doit être multicartes. Non seulement il se consacre à la production, mais on lui demande la compréhension de cet univers stratifié. C’est tout bonnement une mission impossible. »
« La première lutte est donc évidente : il faut combattre le gaspillage alimentaire. C’est une aberration. Pire : une faute morale. Tous les jours, des kilos de nourriture sont mis à la poubelle. Comme le dit Luc, un SDF belge qui zone rue Saint-Denis depuis vingt ans : « On ne peut pas mourir de faim dans une ville comme Paris. Il y a toujours quelque chose à manger dans les poubelles… » La conclusion est flagrante : tous les jours, les restaurants, les magasins d’alimentation, les supermarchés, les cantines, mettent au rebut des denrées qui permettraient de nourrir des familles entières. A l’autre bout du monde, les gens ont faim. »
« L’agriculture fournit, les circuits de consommation écoulent. Le client, lui, sait que les produits portent une date de péremption, précaution née avec le début du XXe siècle, mais qui a mis longtemps à s’imposer. Cette date limite de distribution et de vente est impérative : une fois qu’elle est passée, le produits doit être retiré des rayons et perd toute sa valeur marchande. La conséquence est mesurable : près de cinquante kilos de denrées consommables sont jetés quotidiennement par chaque supermarché. C’est l’équivalent de 500 euros par supermarché. Entre Auchan, Carrefour, Super U, Leclerc, Casino, on dénombre 1600 hypermarchés en France, 5500 supermarchés, 4200 hard-discounts. Soit, au total, 11300 magasins. Livrons-nous à un petit calcul : 11300 multiplié par 365 jours = 1 124 500 jours, multiplié par 50 kilos = 206 225 000 kilos, soit 206 225 tonnes de nourriture jetés tous les jours en France. Hallucinant. Pire. A l’échelle de la planète, c’est 1,3 milliard de tonnes de denrées comestibles par an qui sont jetées. On n’a pas de mots pour qualifier cette honte. »
« Commençons, par exemple, par les fameuses dates limites. Comment sont-elles fixées ? Quels risquent déterminent-elles ? Obéissent-elles à la loi de l’obsolescence programmée (je jette parce que c’est planifié) ou à une autre raison impérieuse ? La DLC (date limite de consommation) a été, paraît-il, inventée pour les yaourts par le père de Bernard Blier qui, de retour d’Argentine (où son fils est né), a eu l’idée, dans l’entre-deux-guerres, de donner une limite de consommation, et de la mentionner sur les petits pots en verre. Cette pratique a mis longtemps à s’imposer. Au début, le système du quantième était en vigueur : ce chiffre donnait simplement la date de fabrication, et nullement la date de péremption. A la fin des années 1980, cependant, le groupe Casino popularise l’usage de cette dernière, déjà en usage en Suisse : c’est un excellent argument de vente. Bonne publicité, donc. Très vite, tous les articles alimentaires sont frappés de cette date de péremption, du jambon à l’huile, du café aux œufs. En 1990, la chose devient obligatoire. Mais nul n’avait prévu les effets pervers. D’une part, une certaine délinquance s’installe. Pour les produits comme la viande ou la charcuterie, il suffit de remballer et de refrapper une nouvelle date, plus lointaine, alors que le produits est périmé. D’autre part, pour les commerçants qui respectent la législation, on se met à jeter. Tricherie d’un côté, gaspillage de l’autre, tout n’est pas rose dans le domaine de la consommation. Et qui ne s’est jamais aperçu que la DLC était souvent surestimée ? Oui, il faut retirer les produits de la vente, mais cela les rend-il impropres à la consommation ? Non. Le « A consommer jusqu’à… » est une règle administrative, non une certitude de pourrissement instantanée. Et il y a la DLUO (date limite d’utilisation optimale) qui commence par « A consommer de préférence avant le… ». La bureaucratie a des nuances… Ici, il s’agit simplement de signaler que les nouilles vont peut-être perdre un peu de leur saveur, ou que les gâteaux secs seront un peu moins secs. Mais en aucun cas, ces denrées ne vont muter en poison violents. »
« Les sociologues se sont penchés sur ce problème. D’où vient cette compulsion à jeter ? Le paysan, autrefois, ne jetait rien. Le moindre bout de ficelle, le clou tordu, le seau percé, tout était récupéré et conservé. Chacun d’entre nous se souvient de ces greniers, dans les fermes de France, où on trouvait de toute : vieilles boîtes en fer pour dragées, moignons de pelotes de fil oubliés, poignées de portes rouillés, manches de fourches cassés… Tout était bon à prendre, un vieux gond brisé ou un fer à cheval retrouvé sur le chemin. Le recyclage était infini, depuis la crotte de vache jusqu’aux vêtements du grand-père. Les sabots faisaient trois générations, l’armoire en chêne se transmettait de père en fils, les draps mille fois recousus faisaient un trousseau acceptable pour la génération suivante… C’était l’éthique de la terre. Ce temps-là est passé. Dans les années 1960, sont apparus les objets à usage unique : briquets, stylos, mouchoirs, gants, couches-culottes, rasoirs, piles, vaisselle en plastique, bouteilles… Le commerce y trouvait son compte (on rachetait), la durabilité était un concept oublié, et la satisfaction du client – devenu un consommateur – y trouvait sa plénitude. »
« « L’eau est précieuse », disait-il. Or, en 1976, personne ne se préoccupait de cette ressource. L’eau était infinie, les océans sans fond, les fleuves éternels, les glaciers aussi. Et puis, peu à peu, les premiers signaux d’alarme sont parvenus : les mers étaient pollués, les bateaux n’arrêtaient pas de rencontrer des obstacles flottants. Des lacs immenses disparaissaient totalement, du fait d’une mauvaise gestion des ressources […] »
« La culture du coton, élément indispensable à l’industrie moderne, absorbe désormais des quantités démentes d’eau, quitte à ruiner des territoires entiers, en Afrique, en les rinçant totalement. Abandonnées, ces terres se latérisent et deviennent complètement mortes. L’une des solutions proposées consiste à choisir des variétés de plantes moins gourmandes en eau. […] la culture du cotonnier est coûteuse, sur le plan bio. Non seulement elle a jadis été la cause de l’esclavage – donc de la déshumanisation de larges segments de population –, mais aussi de l’industrialisation, transformant des villes comme Birmingham ou Manchester en enfers noirs, couverts de crasse et de poussière. Voire Roubaix, aussi, autrefois ville sombre et dominée par les filatures. L’impérialisme britannique a trouvé son élément, avec le coton, et les industriels ont crée un empire du coton à la mesure du pouvoir de la Couronne. Les années ont passé, certes. Les structures politiques et industrielles ont évolué. Le coton, aujourd’hui, est responsable de 25% des insecticides consommés dans le monde, mais ne couvre que 2,5% des terres cultivées. Pesticides, chlore, azurants chimiques : le bilan bio du coton est exécrable, d’autant que la plante est gourmande en eau. Alors que les autres tissus – laine, notamment – sont moins facile à colorer, le coton supporte des teinte diverses et très variées. Mais, pour le teindre, il faut des métaux lourds (plomb, chrome) qui se retrouvent dans les eaux usées. Le résultat est atterrant : selon l’OMS, il y a 1 million de personnes intoxiquées tous les ans dans cette filière, et 22 000 morts. Ajoutons à cela le fait que le coton est une culture millénaire, que les habitudes sont bien ancrées, qu’il est difficile de les changer. Le rebut des cultures fait partie des problèmes dont personne ne s’est préoccupé depuis la nuit des temps. »
« Selon l’OMS, 1,6 million d’enfants meurent chaque année en raison de l’insalubrité de l’eau. Pour en revenir au coton, c’est une plante qui consomme de l’eau en quantité. Selon les lieux, il faut entre 7000 et 29000 litres d’eau pour produire un kilo de coton. Nettoyage, encollage, bain d’amidon, teinture, résine (certains de ces produits, comme les colorants azoïques, sont désormais interdits en Allemagne – mais pas en France), apprêts, traitement antifeutrage, ignifugation, etc. : à chaque étape, de l’eau. Un T-shirt nécessite 25000 litres d’eau et émet 5,2 kilos de CO2… […] En ce qui concerne l’eau, le problème des OGM se démultiplie : la plante ne supportant pas l’ombre, les paysans abattent les arbres en bordure des cultures, appauvrissant les sols. Cette déforestation, en Afrique et en Amérique du Sud, a des conséquences : l’eau pluviale est moins retenue. Dans des pays comme l’Afrique sub-saharienne, c’est la seule façon d’arroser. En revanche, au Soudan, au Pakistan, en Égypte, les cultures cotonnières sont irriguées, d’où des pertes d’eau importantes, une salinisation des sols et une destruction de la terre. »
« La France est le plus important consommateur d’herbicides en Europe. Près de 100 000 tonnes de produits phytosanitaires sont répandus dans nos régions, avec des répercussions très graves. »
Retrouvez mes autres lectures en cliquant : ici !